Entretien - De l'approche morale au questionnement éthique pour les addictions
Dans un entretien, Patrick Daimé, membre de la commission d'aide à la réflexion éthique d'Addictions France, souligne l'importance de récuser l’approche moralisatrice et culpabilisante en lui substituant l’entraide solidaire aux usagers, le développement de la prévention, de la réduction des risques et la facilitation de l’accès aux soins pour toutes et tous. Les enjeux ne se limitent pas au narcotrafic et à la sécurité publique, mais sont aussi ceux de la réduction de souffrances personnelles et sociétales, et de la mise en œuvre de réponses adaptées à cet authentique et préoccupant problème de santé publique.
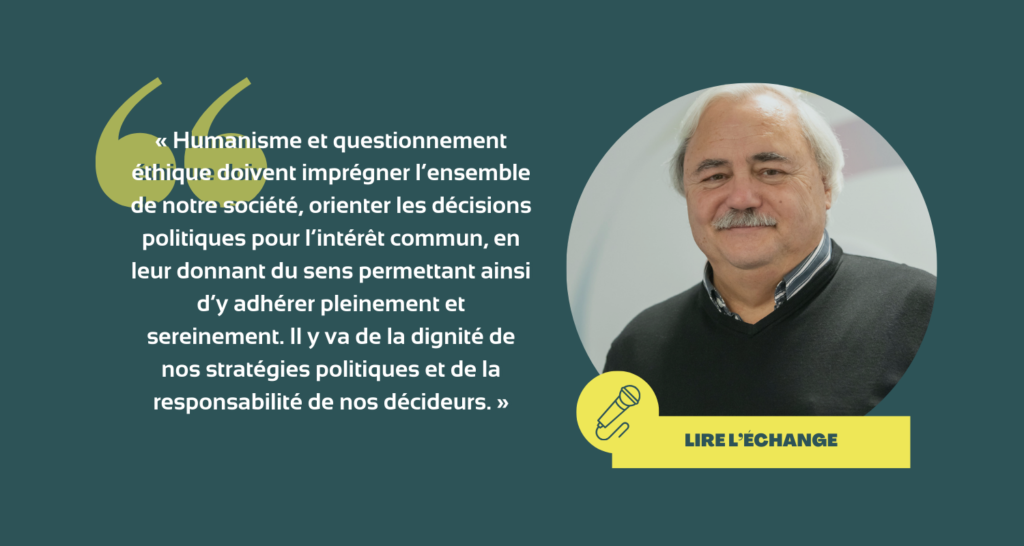
En matière de prévention, les campagnes de sensibilisation et/ou la diffusion de repères de consommation (tabac, alcool, alimentation) sont parfois décriées comme des approches moralisatrices empêchant les gens de vivre. A contrario, sur les drogues illicites, les politiques en appellent à la morale des consommateurs pour enrayer le trafic. Comment distinguer morale et moralisme ? Quelle approche privilégier en matière de prévention et d’accompagnement en addictologie ? Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé Patrick Daimé, vice-président d’Addictions France médecin généraliste et addictologue.
Quel lien faites-vous entre morale, déontologie et éthique ?
Patrick Daimé : Au carrefour de la morale, du droit, et de la déontologie, l’éthique, ses valeurs et ses principes d’action, doit être questionnée. Toute situation complexe impose ce questionnement pour la recherche de la décision efficace et légitime.
La morale consiste à discerner le Bien du Mal. Elle est faite de sentiments et de jugements, et apparaît utile à la vie sociale en incitant chacun à une bonne conduite. La morale est la recherche du Bien commun.
Cette approche est-elle justifiée lorsque l’on parle d’addiction ?
Le narcotrafic, ses réseaux mafieux ayant pour seul et unique objectif l’enrichissement et les paradis fiscaux au détriment de la vie humaine et de la santé publique, la concurrence féroce et sanglante qui les anime, la violence qui les caractérise, mettent en jeu la sécurité et la sérénité publiques. L’approche morale a ici toute sa place. La qualification en matière de bien et de mal est relativement simple, même si on reste dubitatif sur l’efficacité de la moralisation
des gangs de trafiquants. Les interventions à leur égard relèvent sans nul doute des forces de l’ordre et de la justice dans le but de préserver la sécurité publique et il y a bien peu de chances de moraliser le trafic et ses instigateurs.
Les trafiquants et leurs réseaux ne doivent en revanche pas être confondus avec les usagers de substances psychoactives, les patients, à la recherche de « paradis artificiels », qui sont autant de personnes vulnérables et en souffrance et qui relèvent d’actions de réduction des risques et des dommages, de soins et d’accompagnement. Les insuffisances, les échecs de la lutte contre les réseaux, l’impunité des têtes de réseau, ne peuvent ni être masquées ni justifier la répression des usagers, premières victimes du trafic.
Or on constate de plus en plus que l’approche morale est souvent utilisée par les politiques pour culpabiliser les consommateurs de drogues illicites ainsi que les consommateurs de drogues licites (alcool, jeux) lorsqu’ils s’y adonnent jusqu’à l’abus ou l’ivresse. Récemment, l’appel à la morale a été utilisé par l’ex-ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti qui déclarait : « Celui qui fume son petit pétard le samedi, ce pétard-là a le goût du sang séché sur le trottoir »1, puis par le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau : « Un joint a le goût du sang »2. Ces formules-choc, qui participent à la communication politique et à la construction de l’image de l’homme politique, font appel non à la raison mais aux notions de Bien et de Mal, en incluant les consommateurs dans l’écosystème global du trafic. Ces déclarations visent à mobiliser le sens moral des consommateurs en les incitant à se détacher de leurs contacts avec le milieu du trafic de drogues qui est désigné comme le champ du Mal.
Si l’abondance de l’offre de substances psycho actives est un facteur d’accroissement de l’usage de celles-ci, la demande, les besoins ressentis de consommer, comme les contextes de consommation ne peuvent être ignorés. S’il convient de contrôler l’offre, il faut aussi s’acharner, par la prévention notamment, à réduire la demande sociétale en se préoccupant de tous ses déterminants.
Est-ce que cette approche fonctionne ?
Cet appel à la morale pour combattre la consommation de produits psychoactifs n’est pas nouveau. On se souvient d’une autre formule dans les années 80, « La drogue, c’est de la merde », qui voulait instiller l’idée que le consommateur s’avilissait avec la drogue. Elle reprenait le terme « shit » qu’utilisaient les usagers eux-mêmes qui savaient à quoi s’en tenir, d’où son échec. Cette campagne a marqué les esprits à l’époque, mais avec le recul, on constate surtout qu’elle n’a pas été efficace ni sur le moment ni sur le long terme.
Quelles sont les limites de cette approche morale ?
L’approche morale peut marquer les esprits en termes de communication, et si elle peut flatter l’égo de celui qui l’emploie, elle peine à susciter une adhésion suffisamment large pour être efficace et peut s’avérer gravement contre-productive. On voit en effet plusieurs limites :
– Pour être reçue positivement par l’ensemble ou une grande partie de la population concernée, elle suppose que la majorité partage les mêmes principes moraux. Or ils
peuvent être différents pour chacun, car ils dépendent notamment du contexte éducatif, de ce qui est important pour elle dans la vie, …, ;
– Le caractère binaire de l’approche morale n’est pas propice aux nuances et à une politique qui doit s’adapter à des situations diverses et variables, aussi bien en ce qui concerne la consommation que les effets sur la santé ou les circuits de distribution légaux ou non ;
– La morale peut être ressentie comme infantilisante et provoquer des résistances en retour ;
– Les grands courants idéologiques qui structuraient et unifiaient les sociétés au 20ème siècle, et qui pouvaient servir de cadre moral, ont perdu de leur attractivité ;
– Les politiques qui utilisent l’approche morale rencontrent la défiance de l’opinion à leur égard. Seulement 10 % font confiance aux partis politiques selon un sondage paru en 20243. L’image de la classe politique est actuellement très négative, et elle retentit sur les messages que les hommes et femmes politiques veulent faire passer, indépendamment de leur pertinence ;
– Sur le champ des addictions, la complaisance à l’égard des drogues licites (surtout l’alcool) affaiblit la portée des jugements sévères et sans nuance concernant toutes les drogues illicites.
Vous faites une distinction entre morale et moralisation. Pourquoi ?
Moraliser en rendant conforme à la morale peut s’entendre mais le glissement que nous constatons trop souvent au quotidien est celui d’une démarche de moralisation, non pas pour rendre plus moral, mais pour « faire la morale » attitude volontiers contre-productive.
L’écoute de nos concitoyens, l’analyse de leurs attentes et de leurs besoins, constituent des préalables incontournables. Dans un contexte moralisateur et culpabilisant, la détresse des usagers, la souffrance de leurs familles, les difficultés des soignants pour créer et développer une relation thérapeutique…, le questionnement éthique s’impose pour espérer trouver les réponses satisfaisantes à des problématiques complexes.
Qu’ils s’agissent de la prévention, de la réduction des risques, du soin et de l’accompagnement, l’intervention des professionnels s’inscrit dans une relation d’aide et l’éthique y est omniprésente.
Concrètement, comment se fonde cette approche éthique ?
Notre volonté de mettre en place une démarche éthique nous oblige à interroger quelques grands principes qui la fondent et notamment la bienfaisance, la non-malfaisance, le respect de l’autonomie et la justice.
La bienfaisance et la non-malfaisance, grands principes éthiques s’il en est, sont consubstantielles de la démarche médicale, « D’abord ne pas nuire », comme de l’accompagnement médico-social et de l’intervention sociale ! Le « prendre soin » est
indissociable du soin. L’accès aux soins pour tous, l’accueil inconditionnel, doivent être soutenus. La relation d’aide s’appuie sur une relation de confiance réciproque, du respect de la dignité de l’autre, de ses choix, de ses valeurs. C’est sur ces bases que l’alliance thérapeutique peut être construite. L’humanisme, qui est une valeur au cœur du projet associatif d’Addictions France, doit être allié aux compétences mobilisées quel que soit le niveau d’intervention ou de décision.
Et pourtant, la démarche moralisatrice et la culpabilisation des usagers ne peuvent que renforcer les difficultés des usagers dépendants.
Jugement et moralisation n’ont pas leur place dans une relation d’aide et de soins digne de ce nom. Il ne s’agit pas ici de dédouaner l’usager de toute responsabilité, de ses choix malheureux ou inadaptés, mais surtout de ne pas l’enfoncer, par un discours jugeant et moralisateur, dans la culpabilité, l’isolement, la précarité qu’elle soit psychologique ou sociale, autant de déterminants bien connus de la consommation de drogues !
Au contraire, le développement de la prévention, l’accès à la réduction des risques et aux soins, la multiplication de possibilités d’accompagnement pour tous et en tous lieux, la réduction des inégalités sociales de santé, sont des mesures éthiques indispensables tant pour les personnes consommatrices que pour les professionnels qui doivent pouvoir travailler en étant en accord avec leurs valeurs professionnelles et leurs déontologies.
Dans les grands principes éthiques, vous citiez aussi l’autonomie.
L’autonomie morale, au sens de Kant, est la capacité de délibérer et de se donner à soi-même la loi morale, plutôt que de se contenter de tenir compte des injonctions des autres. L’autonomie personnelle est la capacité de décider par soi-même et de poursuivre une ligne de conduite dans sa vie, souvent sans tenir compte d’un contenu moral particulier (EREN). Quid de son libre arbitre, de son autonomie, quand les seuls choix personnels autorisés sont dictés par autrui ; quand d’autres décident de ce qui est bien ou mal, ce qui est bon ou pas, pour vous.
La consommation de drogues, quelle qu’elle soit, provoque in fine une situation de fragilité, de vulnérabilité et de dépendance qui induit une perte d’autonomie, une perte du libre choix, aggravées par l’enfermement dans l’illégalité compliquant l’accès à la réduction des risques comme aux soins.
Contrairement à la culpabilisation, l’information, claire, loyale et appropriée, le travail motivationnel, dans le respect de l’autre, sans jugement, sont à même de favoriser l’autonomie de la personne. L’information doit pouvoir être diffusée partout, pour toutes et tous, les capacités d’analyse développées, les compétences personnelles renforcées pour que la capacité à l’autonomie soit restaurée et le libre arbitre retrouvé.
Tout n’est pas blanc ou noir, bien ou mal, la Personne, son autonomie, sa responsabilisation, se construisent à travers ses choix et son libre arbitre, le respect de son autonomie, au mieux orientés par les efforts d’éducation à la santé et la prévention, qui restent les parents pauvres des politiques publiques.
Comment assurer aussi Equité et Justice ?
Au-delà des aspects individuels, les drogues et les stratégies politiques à leur égard, remettent en cause d’autres principes éthiques que sont l’équité et la justice. Les conduites addictives, la consommation de drogues, constituent des enjeux majeurs de santé publique. Elles aggravent singulièrement les inégalités sociales de santé, la marginalisation, les difficultés d’insertion…, encore renforcées par la stigmatisation et la culpabilisation, et mettent en jeu la santé publique, notre bien commun.
L’équité, la justice, pour l’insertion dans une vie sociale équilibrée, pour la sécurité, comme pour l’accès aux soins sont menacées avec les conséquences que l’on mesure au quotidien. Les grands principes de la République, « liberté, égalité, fraternité », nos fondements démocratiques, notre démarche éthique, la réflexion collégiale, doivent sans cesse nous guider dans l’approche de ce fléau, dont nos concitoyens sont les victimes.
L’équité, la justice devraient valoir aussi pour l’approche politique des consommations des différents produits, qu’ils soient licites ou illicites. Le tabac et l’alcool, drogues licites, sont, de très loin, celles qui impactent le plus la santé publique ; l’alcool est aussi un problème quotidien en matière de sécurité publique. Pour mémoire l’alcool, contrairement aux drogues illicites dangereuses essentiellement pour le consommateur, est aussi et surtout dangereux pour les autres.
Il s’agirait donc que ces principes se traduisent par de la cohérence politique et une même détermination des pouvoirs publics à l’égard de ces fléaux ?
La question de la justice renvoie volontiers à celle des responsabilités, individuelle, collective, sociétale, politique…, qui doivent être questionnées, non pas pour porter un jugement mais pour mieux identifier les leviers à actionner pour réduire les inégalités et renforcer l’équité. Aujourd’hui, la justice elle-même se veut « résolutive de problème ».
La stratégie politique, l’approche citoyenne, comme la démarche d’accompagnement, de la prévention à la réduction des risques et aux soins doivent s’abstenir de toute stigmatisation et culpabilisation, mais se fonder sur une solidarité sans faille.
À la démarche moralisatrice, dogmatique, et aux injonctions, sans donner les moyens de les mettre en œuvre, nous préférons le cadre de nos valeurs humanistes, la déontologie de nos professionnels, et nous déterminons nos positionnements et nos actions à l’issue d’une réflexion collective et d’un questionnement éthique, menés à chaque fois que nécessaire.